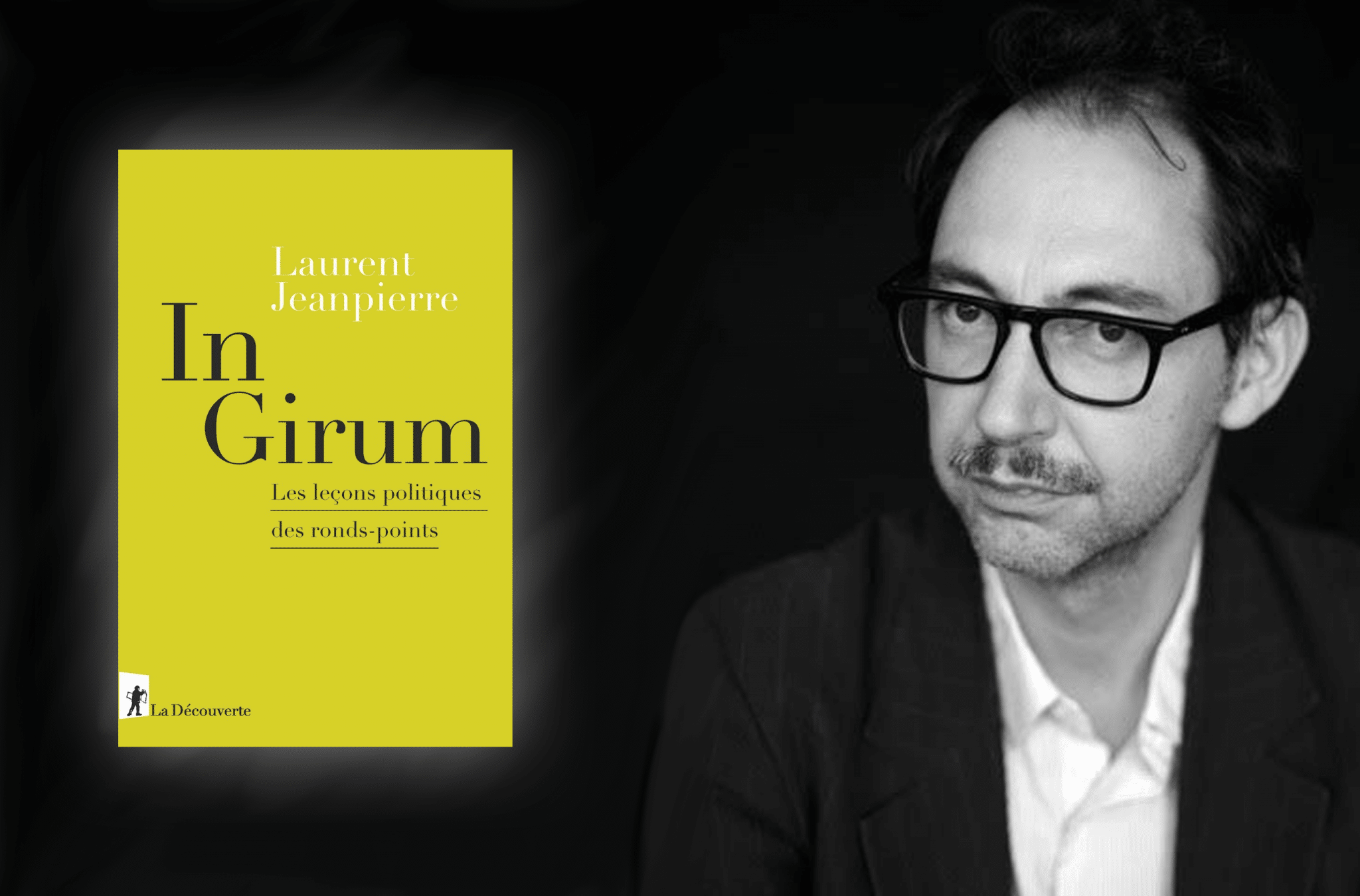Allan Popelard, Grégory Rzepski et Antony Burlaud ont dirigé le livre-somme qui paraît cette rentrée aux Éditions Amsterdam : Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale. Ouvrage inédit dans son genre, il rassemble les contributions de près de quatre-vingt-dix auteurs, rendant sensible l’infiltration du néolibéralisme dans toutes les sphères de nos quotidiens. Loin d’être une seule doctrine économique, il est en effet un projet total de société, qui continue de formater nos existences collectives et individuelles, contraintes de s’adapter au nouveau monde de la concurrence généralisée. Les promesses de « Révolution » du candidat Macron en 2016, issues d’un essai diffusé au cours de la campagne présidentielle, n’étaient toutefois guère autre chose que des artifices rhétoriques. Un monde très ancien, à l’avantage d’une poignée d’élites ayant fait sécession, tel est l’authentique visage du néolibéralisme, que documente ce vaste tableau de la France d’aujourd’hui. On y trouvera aussi des armes pour défaire l’hégémonie néolibérale : délégitimer son ambition, désigner ses responsables, déconstruire sa langue, et lui substituer un « nôtre » monde. L’heure en est décisive tant le néolibéralisme vacille à mesure des crises politiques, sociales et écologiques qu’il engendre et que la répétition du « nouveau » pourrait bien avoir des conséquences catastrophiques. Entretien réalisé par Laëtitia Riss.
LVSL – Un constat paradoxal ouvre l’ouvrage. Vous écrivez que le mot néolibéralisme est désormais « très usité mais un peu usé », tout en faisant l’objet de ce livre. Que désigne alors, pour vous, le néolibéralisme ?
Allan Popelard – Nous avons conçu Le Nouveau monde comme une somme. Un tableau ample et détaillé, analytique et sensible, auquel ont participé des chercheurs, des journalistes, des écrivains, des praticiens et puis des travailleurs qui font le récit de leur vie au travail. Avec les méthodes d’investigation qui leur sont propres, à travers diverses formes d’expression, les contributeurs du livre documentent un ensemble de phénomènes : la polarisation sociale et le creusement des inégalités, la généralisation des logiques de marché, l’emprise de la finance, l’expansion du privé au détriment du public, la montée de la bureaucratie, la fragilisation des collectifs, la prédation des communs, la déréglementation, l’Etat démantelé… Or il nous a semblé que le concept qui permettait, malgré tout, de réunir ces différents éléments et d’agencer ces diverses tendances, était celui de « néolibéralisme ». Néolibéralisme que nous comprenons de manière large, comme un projet de société qui façonne jusqu’aux plus intime des vies. Plus qu’une doctrine économique, donc, ou que le volet d’un programme politique : une reconfiguration assez profonde de l’ordre social, un chambardement des valeurs.
LVSL – Les historiens nous apprennent à nous méfier du « nouveau ». Plusieurs contributions de l’ouvrage montrent en quoi le néolibéralisme s’inscrit dans certaines continuités (Pierre Serna décrit un « Thermidor infini » et prolonge le devenir de l’extrême-centre, Johann Chapoutot identifie dans le darwinisme de la fin du XIXème siècle les racines des pratiques managériales, Gérard Mauger rappelle que le vieil esprit du capitalisme a trouvé comment faire son rebranding actuel, etc.) et n’est pas si révolutionnaire que ses défenseurs le prétendent…
A. P. – Le centre de gravité du livre se situe dans la période la plus récente. Une période marquée par une crise organique et la prise de pouvoir d’un « bloc bourgeois ». Mais, en effet, nous insistons sur quelques moments qui présentent des analogies avec la séquence actuelle. Le retour sur la période thermidorienne permet de comprendre la permanence depuis la Révolution française et la fin de la Convention montagnarde d’un « extrême-centre », avec sa rhétorique de la modération, son autoritarisme, ses muscadins et l’armée de girouettes qui le soutient. Comme en regard, Mathilde Larrère montre comment les mobilisations sociales actuelles, le mouvement des Gilets Jaunes tout particulièrement, réactualisent des imaginaires, voire des pratiques, de la Révolution française ou de la Commune.
Grégory Rzepski – Si son livre-programme s’intitulait Révolution, en réalité, Macron a persévéré dans une voie tracée par ses prédécesseurs immédiats. En France et ailleurs. La contribution de Serge Halimi au Nouveau Monde revient sur l’engrenage néolibéral : comment on a privatisé les grandes entreprises françaises parce qu’une fois les frontières ouvertes, on ne doit pas pénaliser la concurrence étrangère ; comment on sacrifie les salariés parce qu’on a privatisé… Dans un autre registre, mais dans la même perspective généalogique, des auteurs comme François Jarrige ou Félix Tréguer reviennent aux sources du technosolutionnisme actuel, tandis que Christophe Bonneuil retrace les étapes de la contre-révolution anti-écologique à laquelle nous faisons face. Le « nouveau monde » constitue donc la continuation, et dans quelques domaines la radicalisation, de tendances qui travaillent la France depuis plusieurs décennies.
LVSL – Dans « Jupiter et les siens », Antony Burlaud rappelle la sociologie très homogène du macronisme, aussi bien dans ses équipes gouvernementales que dans ses soutiens électoraux : cadres du privés entrés dans les affaires publiques, franges de la population à haut patrimoine, élites intellectuelles et administratives passées par les grandes écoles… Comment comprendre l’avènement de ce nouveau « bloc bourgeois », qui jusqu’à lors semblait se satisfaire d’un libéralisme plus diffus et consensuel ?
G. R. – Nous avons fait le choix, politique, de nous intéresser non pas à la seule oligarchie mais à la « bourgeoisie ». Ceux qui disposent du capital, ou plutôt des différents types de capitaux. Des cadres, des médecins, des avocats, des créatifs, et bien sûr des journalistes, sans lesquels les très riches ne pourraient perpétuer leur domination, sans lesquels les 1% ne se maintiendraient pas une heure au pouvoir. Se focaliser sur l’oligarchie empêche de voir l’existence en France d’une élite de masse : les 1%, et tout un halo autour, jusqu’aux 38 % d’enseignants qui ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour de l’élection présidentielle. Alors, certes, par rapport à ce qui s’est joué dans d’autres pays où les compromis sociaux dominants n’étaient pas les mêmes, ce moment macronien arrive à retardement. Comme le montre le premier chapitre de Bruno Amable et Stefano Palombarini, il finit par arriver notamment en raison de crises endogènes des blocs qui organisaient la vie politique jusqu’alors et parce que se structure un nouveau bloc, le bloc bourgeois, qui accède au pouvoir avec un projet, réaliser enfin un vieux rêve, imposer le néolibéralisme.

A. P. – Ce bloc bourgeois ne compose plus avec les classes populaires, ne fait même plus mine de s’y intéresser. Il fait preuve d’un mépris social parfaitement assumé, parle une langue de plus en plus déboutonnée, et sa propension au séparatisme est de plus en plus nette. Ce séparatisme de la bourgeoisie, qui fait l’objet d’une partie du livre, mais peut aussi fonctionner comme un fil rouge de lecture, est le produit de ce que Pierre Rimbert appelle « le tamis du savoir et de l’argent ». Une « contre-société » se constitue à partir d’une élite nantie de ses diplômes, qui vit dans le cœur des métropoles, est convaincue d’incarner le camp du bien et de la vertu, et finit par prescrire les formes de la vie bonne à toute la société. Un exemple frappant, c’est l’école : Laurence de Cock montre bien comment la démolition des services publics d’éducation a pour corollaire un entrain pour le privé ou bien pour toutes les écoles dites « alternatives », qui permettent de s’excepter du peuple, de reproduire le processus de distinction et d’entretenir le goût de la sécession. Mais on retrouve des logiques analogues s’agissant de la santé, de la mobilité, du logement, ou de l’alimentation à laquelle le géographe Gatien Elie consacre un superbe texte…
LVSL – En contraste avec cette frange sociale minoritaire mais très puissante du pays, plusieurs pages de votre ouvrage sont dédiées à des témoignages qui brossent le portrait du quotidien de nombreux Français. Ce « monologue des travailleurs » ne mérite-t-il pas d’être converti en une solidarité nouvelle, qui puisse dépasser la simple juxtaposition de paroles ?
A. P. – Le cœur du Nouveau Monde n’est pas dévolu par hasard à cette cinquantaine de récits, qui racontent l’expérience quotidienne du travail. Il y a une première raison, disons d’ordre compositionnelle : on a voulu construire un livre-somme, mais aussi un livre qui soit agréable à lire et dans lequel on puisse entrer de différentes façons et depuis différents lieux. Si l’on commence par cette partie dédiée aux travailleurs, on découvre la vie d’ouvriers, de caissières, de hauts fonctionnaires, de femmes de ménage, d’ambulanciers, de consultantes, d’art advisor, de légionnaires, de conseillère pôle emploi… qui racontent leur vie au travail On trouve aussi le récit de celles et ceux qui ont perdu leur travail.
La deuxième raison, plus fondamentale peut-être, tient à ce que, comme l’expliquait Pierre Bourdieu dans un entretien avec Günter Grass, la violence du monde social ne peut pas être rendue exclusivement par une approche conceptuelle. Il faut alors lui adjoindre d’autres formes, capables de la saisir de manière plus fine, plus sensible, plus frontale aussi. D’où le dispositif retenu pour La Misère du monde – qui constitue avec Working du journaliste américain Studs Terkel une des sources d’inspiration pour cette partie. Et parce que la brutalité du néolibéralisme est plus manifeste au sein du monde de travail – et du travail ouvrier en particulier –, cette histoire orale de la France s’ouvre par le « récit posthume » d’un ouvrier-fondeur mort à la tâche. La sociologue Anne Marchand l’a écrit à partir des archives du CHSCT et d’archives personnelles.
G. R. – Ce qui revient en filigrane dans presque tous ces témoignages, c’est une expérience commune de dépossession, l’expérience d’un travail qui n’a plus vraiment de sens pour ceux qui l’accomplissent. Peut-on cimenter un bloc populaire autour de ce sentiment de dépossession ? La question reste ouverte, mais il est certain que la solidarité des travailleurs ne prend plus les formes qu’elle pouvait connaître. Et pour cause, le néolibéralisme n’a pas manqué d’inscrire des divisions partout où elles étaient possibles. On pourrait dire qu’il y à la fois une base matérielle pour un bloc populaire et une impasse idéelle, liée à la fausse conscience d’une certaine élite qui peut être amenée à partager le sentiment de dépossession mais n’est pas toujours prête à en faire un vecteur de politisation contre l’ordre établi.
LVSL – À défaut de bloc populaire, la France néolibérale est pourtant loin d’exprimer la voix de la majorité. Comment expliquer qu’elle tient, malgré tout ?
A. P. – C’est une des questions centrales du livre, autant qu’une des contradictions dont nous sommes les contemporains. Pour essayer d’y répondre, pour comprendre comment le néolibéralisme a gagné le sens commun, on a accordé une place importante à la production de l’idéologie dominante. L’article de Gérard Mauger poursuit ainsi l’enquête que Pierre Bourdieu et Christian Boltanski avait réalisé sous le mandat de Giscard d’Estaing et dresse à ce titre une petite encyclopédie des idées reçues. Il inventorie ces « discours sans sujet », qui circulent dans les écoles du pouvoir, les partis politiques, les think tanks, les cabinets de conseil, les instituts de sondages, et sur les plateaux de télévision bien évidemment… Par ailleurs, plusieurs textes, comme ceux de Nathalie Quintane ou Sandra Lucbert insistent sur la scène discursive du néolibéralisme et sur la manière dont la langue peut neutraliser, censurer ou récupérer la critique. Enfin, la dernière partie du livre cherche à déplier et déconstruire les « mythologies » du néolibéralisme, qui se cristallisent souvent dans la langue. Des auteurs comme François Bégaudeau, Éric Chauvier, Laurent Binet ou Evelyne Pieller y ont contribué.
G. R. – Dans son texte, Frédéric Lordon note que les dominants ne parlent plus la même langue que le reste de la société, révélant le basculement dans une économie morale hétérogène à celle du peuple. Quand par exemple le secrétaire national d’un syndicat de police commente sur CNews la mutilation d’un Gilet jaune dont la main a été arrachée par une grenade d’un « c’est très cru mais c’est bien fait pour sa gueule ». Comme le rappelle la citation de ce policier du reste, le maintien de l’ordre n’est pas qu’une affaire de signes et de mots. La partie du livre consacrée au « néolibéralisme autoritaire » revient sur l’emprise policière, les lois d’exception, la surveillance numérique ainsi que sur la dette, le « dialogue social » ou le chômage de masse comme instruments de ce maintien de l’ordre.

LVSL – Pour qui veut s’opposer à la puissance néolibérale, les options paraissent souvent restreintes. Les luttes les plus victorieuses, ces dernières années, semblent être les luttes « locales » qui se réapproprient des espaces et des pratiques communes. Pourtant, Aurélien Bernier invite dans son article à la prudence à l’égard du « localisme » qui ne cesse d’être instrumentalisé par les pouvoirs en place – songeons à ce nouveau mot d’ordre qu’est devenu « La France des territoires ». Doit-on alors plutôt réinvestir l’échelon national, en refusant à la fois les illusions de la proximité et de la mobilité qui sont désormais les lieux communs de nos politiques ?
A.P. – Aurélien Bernier montre en effet très bien que les luttes locales sont à la fois un des points d’appui contre l’expansion du néolibéralisme (les luttes écologiques contre les grands projets inutiles, l’action des associations contre les effets de la métropolisation, ou plus récemment l’ancrage local du mouvement des Gilets jaunes) et un des lieux les plus propices au détournement de la contestation. Le « local » a ainsi pu être récupéré de plusieurs façons : par l’extrême-droite, sur un mode identitaire qui verse très rapidement dans la défense ethnique d’un territoire ; par les plus riches qui entendent préserver leur cadre de vie en mobilisant toutes leurs ressources– dans son chapitre sur la sécession spatiale de la bourgeoisie, la géographe Cécile Gintrac rappelle comment les communes aisées de l’ouest parisien ont obtenu l’abandon de la construction du tronçon occidental de l’A86 ; et par le capitalisme en général, qui alimente la compétition entre les territoires, tout en feignant de s’en rapprocher.
G.R. – C’est un nœud problématique qu’Aurélien Bernier suggère de dépasser en ne dédaignant pas a priori la reconquête de l’État. Faire enfin advenir notre Etat. Car, outre son démantèlement, on constate, depuis quelques années, une forme de capture : de plus en plus, dans la conception, la conduite, voire le contrôle des politiques publiques, le privé copilote, ou prend carrément la main. Cela va du recours aux partenariats public-privé, les PPP, conclus avec les majors du génie civil pour opérer des équipements publics, à l’importance prise par les banquiers d’affaires dans le suivi des dossiers de Bercy en passant par les « niches fiscales ». Du crédit impôt recherche au mécénat, le coût de ces incitations a triplé depuis le début des années 2000 pour atteindre de l’ordre de 100 milliards d’euros. Or, grâce à elles, les contribuables d’élite ont le privilège de concourir à orienter et à hiérarchiser les choix politiques. A à tel point qu’on pourrait y voir le retour à une démocratie censitaire. La contribution d’Antoine Vauchez présente l’ensemble de ces évolutions comme constitutives d’« un interventionnisme libéral ». Le néolibéralisme n’abolit pas l’intervention de l’État ; il prône, pour la conduire, une collusion renouvelée entre public et privé ; il la réoriente, en particulier pour tenter de conférer un peu de réalité aux idéaux capitalistes, l’accumulation perpétuelle et la concurrence non faussée. Voire l’homo economicus : quand le chapitre de Sarah Abdelnour analyse les politiques publiques en faveur de l’auto-entreprenariat, celui d’Isabelle Bruno et Grégory Salle sur la bureaucratie montre comment la comptabilité de soi s’impose au cœur-même de l’Etat, en prenant l’exemple du chercheur « incité » à objectiver ses performances (et à les comparer à celle de ses collègues) en recensant sur sa page Internet le nombre de ses publications.
LVSL – « Pour construire un autre nouveau monde, le nôtre » conclue la 4ème de couverture. En traversant cette somme collective, il semble qu’on puisse décliner cette opposition : Leur État et le nôtre, leur République et la nôtre, leur travail et nôtre, leur Progrès et le nôtre, leur École et la nôtre, leur écologie et la nôtre, leur féminisme et le nôtre… Le défi est-il aujourd’hui de se réapproprier le langage commun qui nous unit à la politique ?
A.P. – Ce livre est d’abord une enquête qui vise à documenter, le plus correctement possible, les logiques et les effets du néolibéralisme en France, pas un programme politique ou une panacée, même si vous avez raison de noter qu’en creux des articles se dessine un autre monde, qui pourrait être le nôtre. En cela, il occupe une place modeste dans la division du travail politique. Notre souhait serait que l’ouvrage puisse servir de point d’appui aussi bien à la critique du néolibéralisme qu’à la lutte contre lui. Cela prendra peut-être des formes auxquelles on ne s’attend pas nous-mêmes. D’autant que cet ouvrage a été construit à partir d’un large collectif, qui n’est pas homogène en soi, et qui n’est pas en accord sur toutes les solutions à apporter.
G. R. – Alors que le livre a été fabriqué dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie, le lancement présage des rapprochements entre des auteurs qui habituellement ne se rencontrent pas. On voudrait espérer que quelque chose advienne, même très simplement, au sein de ce collectif d’universitaires, d’écrivains, de militants, de travailleurs… D’ores et déjà, bien sûr, des réactions et des oppositions à l’ordre établi existent – c’est l’objet de la sixième partie du livre. Mais comment faire que ce refus de l’ordre (ou du désordre) néolibéral ne revête pas une forme réactionnaire et contribue plutôt à faire advenir des politiques d’émancipation ? C’est tout l’enjeu de la séquence dans laquelle nous sommes.
Liste des contributeurs de l’ouvrage :
Sarah Abdelnour, Sabrina Ali Benali, Bruno Amable, Philippe Bacqué, Camille Beauvais, François Bégaudeau, Sophie Béroud, Aurélien Bernier, Laurent Binet, Laurent Bonelli, Christophe Bonneuil, Michel Bozon, Gérard Bras, Benoit Bréville, Isabelle Bruno, Antony Burlaud, Éric Chauvier, Johann Chapoutot, Hadrien Clouet, Laurent Cordonnier, Denis Colombi, Laurence De Cock, Amina Damerdji, Jean-Marie Delarue, François Denord, Thierry Discepolo, Gatien Elie, Sophie Eustache, Amélie Ferrand, Nicolas Framont, Pierre François, Simone Gaboriau, Julie Gervais, Cécile Gintrac, Samuel Gontier, Guillaume Gourgues, Serge Halimi, Christophe Hanna, Camille Herlin-Giret, Vincent Jarousseau, François Jarrige, Fabien Jobard, Anne Jourdain, Raphaël Kempf, Rachel Knaebel, Aurore Koechlin, Paul Lagneau-Ymonet, Renaud Lambert, Jérôme Lamy, Mathilde Larrère, Frédéric Lebaron, Gérald Le Corre, Claire Lemercier, Thomas Le Roux, Danièle Linhart, Frédéric Lordon, Marius Loris, Sandra Lucbert, Nelo Magalhaes, Anne Marchand, Gérard Mauger, Michel Offerlé, Ugo Palheta, Stefano Palombarini, Evelyne Pieiller, Frédéric Pierru, Jean-Luc Porquet, Christian Prigent, Nathalie Quintane, Clément Quintard (illustrations), Mathias Reymond, Hélène Richard, Pierre Rimbert, Anne-Cécile Robert, Claire Rodier, Max Rousseau, Mathias Roux, Grégory Rzepski, François Ruffin, Rachel Saada, Arnaud Saint-Martin, Grégory Salle, Julien Sartre, Antoine Schwartz, Pierre Serna, Vincent Sizaire, Félix Tréguer, Antoine Vauchez, Xavier Vigna.